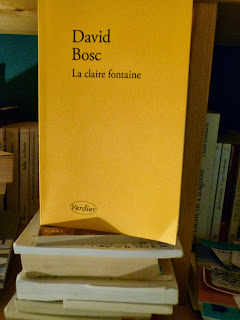 |
| © Romain Buffat |
Souvent annoncé comme la belle surprise de cette rentrée littéraire, La claire fontaine* de David Bosc enchante la plupart des lecteurs. Ils saluent une écriture travaillée, sensuelle, proche de la peinture.
Il y a une époque où l’on ne venait pas en Suisse pour y
planquer quelques bijoux, deux bagnoles, un yacht, un compte en banque et
construire un chalet entouré de nains de jardins et d’angelots joufflus ;
il y a un temps où l’on s’exilait en Suisse pour de bonnes raisons :
sauver sa peau, peindre, redevenir libre.
Ce fut le cas de Gustave Courbet, peintre immense, devenu
pour l’occasion héros du troisième roman de David Bosc, paru aux éditions
Verdier.
Alors en exil en Suisse après avoir participé lors de La
Commune au déboulonnage de la colonne Vendôme qu’il doit reconstruire à ses
frais, c’est un joyeux Courbet que nous donne à voir David Bosc : il a une
belle bedaine, il aime le Chasselas, il aime la peinture, il aime les bains. Le
décor est idyllique, le Léman, la Tour-de-Peilz, il chante dans une chorale, se
mêle à la vie de sa terre d’accueil, participe au Grand-Tout, continue de
peindre et de bien peindre.
Plus qu’un exercice de style, étape appréciée de bon nombre
d’écrivains qui veulent un jour parler de peinture, David Bosc nous livre ici
un récit qui gravite autour de la liberté. Que ce soit la liberté de se baigner
en dehors des heures et des zones prévues, la liberté de fumer et boire comme
cela lui chante, la liberté artistique, la liberté de chanter aigu, la liberté
d’insulter les policiers… le Courbet de Bosc incarne la figure de l’homme qui
se « gouverne lui-même » :
« Courbet n’a jamais tisonné la foule. S’il grimpait sur une chaise, c’était pour chanter, pas pour crier : à mort ! Il a montré des tas de choses en vivant comme il l’entendait. Point de jérémiades sur le malheur des opprimés : l’amour abstrait des philanthropes le faisait reculer d’horreur, ce cœur navré qui coule et se répand sur les plaies rhétoriques de gens dont on ignore la douleur… Courbet a exercé sa liberté. Il était opiniâtre. Sa politique ? Pour tous, la liberté, c’est-à-dire se gouverner soi-même. Il ne déplorait rien. Il ne s’occupait pas de revendications (il n’était pas question de demander quoi que ce soit). Pour le reste, et jour après jour, ne rien céder de ce qu’on peut tenir. Pied à pied. Ne rien abandonner à cela qui mutile, prive, colonise, retranche, arraisonne, greffe, assujettit, entrave, équipe, ajuste, équarrit. Le corps est un champ de bataille. La nature est un champ de bataille. Le réalisme de Courbet est une riposte à la fable sociale, au fameux modèle de société, à la civilisation, au programme des écoles des classes asservies, au programme des écoles de classes dirigeantes, aux recueils de lecture à l’usage des jeunes filles. Le réalisme de Courbet lacère les décors derrière lesquels on accomplit la sale besogne, il déchire les toiles peintes : les bouquets d’angelots par-dessus les théâtres, les fées clochette, les diables, les allégories en fresque dans les écoles et dans les gares, où l’on voit les déesses de l’industrie et de l’agriculture, les splendeurs des colonies et les prodiges de la science.
Au mur de son atelier, à Paris, Courbet avait affiché une liste de règles :
1. Ne fais pas ce que je fais.
2. Ne fais pas ce que les autres font.
3. Si tu faisais ce que faisait Raphaël, tu n’aurais pas d’existence propre. Suicide.
4. Fais ce que tu vois et ce que tu ressens, fais ce que tu veux. »
L’extrait parle de lui-même. Le livre de Bosc est documenté
mais la pédanterie absente. Au contraire, le lecteur peu au courant de la vie de Courbet pourrait
bien se perdre (ç'a été mon cas) géographiquement ou chronologiquement tant la
prose dense de Bosc étonne et nous sort d’une lecture linéaire, classique. On
prend ses paragraphes comme des tableaux, ses phrases comme les mouvements
d’une sonate ; La claire fontaine
est un pur objet d’art.
Il y a aussi des personnages qui passent, juste là,
derrière. On aperçoit Rimbaud, le « bras en écharpe » qui vient de
jeter « l’ordre d’expulsion prononcé contre lui par un juge de Belgique ».
Il a franchi une frontière, cette « pauvre chose ». Baudelaire lui
aussi, apparaît, dans un souvenir de Courbet qui avait logé le jeune poète
alors âgé de vingt-six ans, dans le coin de sa piaule. L’un avait été peint par
l’autre en 1848. La même année, ils étaient allés ensemble aux barricades.
Le livre de Bosc, c’est aussi la description d’un pays. Le
canton de Vaud, ses traditions et les rives du Léman, rendues sublimes comme
si des toiles de Courbet on en avait retiré que le Verbe :
« le premier plan accueille la joie du monde, son enfance, la fraîcheur d’un matin de mai. Une fille pieds nus s’est assise au soleil, entourée de ses chèvres, sur l’herbe épaisse des prairies les moins hautes. La violence inouïe des montagnes est comme interrompue, figée – la catastrophe est tenue à distance par l’espace évidé du lac. Bleu, noir, prasin. Entre l’amoncellement de matière chaotique et les petits pieds nus, l’œil amorce un va-et-vient, un cercle qui l’instruit. »
Enfin, il y a le titre, La
claire fontaine, à savoir toutes les eaux dans lesquelles Courbet se baigna, heureux et libre. Les eaux limpides ce sont aussi les pages de Bosc. Nul doute que le
lecteur y trouvera l’eau si claire qu’il y barbotera avec joie !
* David Bosc, La claire fontaine, roman, Verdier, 2013.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire