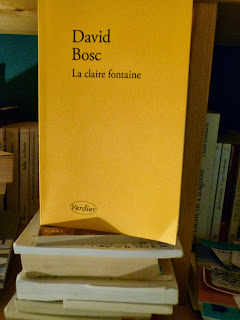(ou de la littérature comme un don d'organes)
« Le bon vieux cœur. Le cœur moteur. La pompe qui couine, qui se bouche, qui déconne. Un boulot de plombier, aime-t-il dire : écouter, faire résonner, identifier la panne, changer les pièces, réparer la machine, tout cela me convient parfaitement… »
Il y a quelques semaines déjà que j’ai fini la lecture de Réparer les vivants de Maylis de Kerangal, que je vis avec ce livre, que je le porte, et mon cœur palpite encore.
Ce billet ne dira pas beaucoup de l’histoire de Réparer les vivants. C’est plutôt une
déclaration d’amour faite à l’écriture de son auteure. Même si j’étais déjà
conquis après Corniche Kennedy, Naissance d’un pont et Tangente vers l’est, il faut bien
avouer que là, j'ai été foudroyé à chaque page, et suis resté bouche bée une fois le livre refermé. Livre que j’ai
aussitôt rouvert et que je continue d’ouvrir, tous les jours, puisqu’il ne rend
jamais son dernier souffle, comme l’écriture de Maylis de Kerangal, défibrillateur de mots, souffle, halète, se syncope mais qui toujours repart.
L’histoire est celle d’un cœur, « boîte noire
d’un corps de vingt ans », celui de Simon Limbres, cœur que la « joie
dilate » et la « tristesse resserre », que l’amour « a fait
fondre » : un cœur donc qui fonctionne. Un cœur qui continue de
fonctionner quand Simon Limbres, lui, meurt dans un accident de voiture, car on
sait depuis 1959 que « c’est désormais l’abolition des fonctions cérébrales
qui [l’] atteste la mort ».
Et la suite est une frénésie, une course alors que les
proches, les parents – Marianne et Sean – voudraient le repos que le médecin
empêche : « Nous sommes dans un contexte où il serait possible que
Simon fasse don de ses organes. » (Notez l’étrange formulation alors que
Simon Limbres est en état de mort cérébrale (« …que Simon fasse… »)) Pour
l’heure pas le temps pour le deuil, ce qu’il faut c’est « enterrer les
morts et réparer les vivants ». Cette phrase empruntée à Tchekhov est au cœur du livre (vous pouvez compter les pages, les chapitres et les
blancs).
Voilà pour l’histoire et je n’en dirai pas plus.
Ce qu’il faut dire en revanche c’est l’immense
travail de recherche effectué par l’auteure et l’immense réussite qui en découle, ce qui n’allait pas de soi : parvenir à rendre tout cela romanesque, sans
que transpire le savoir, sans que ça fasse lecture
pour apprendre des trucs sur la médecine et le don d’organes. Le livre
s’attache plutôt à montrer, à faire voir, à faire sentir ce que c’est que
d’être un jeune homme de vingt ans qui se lève la nuit pour aller surfer ;
ce que c’est que d’être celle qui reste au lit et l’attend ; ce que c’est
que d’être une mère, un père à qui on annonce la nouvelle terrible ; ce
que c’est que d’être la petite sœur de Simon Limbres qu’on a oublié de prévenir
parce que la journée a été longue ; ce que c’est que d’être médecin ou
chirurgien et qu’on avait planifié ce soir-là de regarder le match
France-Italie ; ce que c’est que d’avoir attendu toutes ces années un
nouveau cœur.
Maylis de Kerangal lie ses personnages grâce à une écriture qui
mêle les points de vues et les niveaux de langage, la voix du narrateur et
celles des personnages. Exemple quand la mère et le père (séparés) de Simon se
retrouvent dans un café ; celle-là a appelé celui-ci pour lui annoncer
qu’il était arrivé quelque chose à leur fils :
« Alors Marianne s’est armée de courage – armée, oui,
c’est exactement cela, il y a cette agressivité nue qui ne cesse de croître
depuis leur étreinte et dont elle se barde, comme on se protège en brandissant
au-devant de soi la lame du poignard – et, toute droite sur la banquette, a
débité les trois propositions qu’elle avait préparées – ses yeux sont fixes.
Quand il entend la dernière – « irréversible » –, Sean secoue la tête
et son visage s’agite, convulsé, non, non, non, puis il se lève, lourd,
bouscule la table – le gin passe par-dessus le verre –, se dirige vers la
porte, les bras le long du corps et les poings serrés comme s’il transportait
des poids, la démarche d’un homme qui sort casser la gueule à quelqu’un, qui
déjà le cherche, et une fois dehors sur le pas de la porte, il fait une brusque
volteface, revient à la table qu’ils occupaient, avançant dans le rai de
lumière tracé au sol, et sa silhouette à contre jour est nimbée d’une pellicule
grisâtre : la sciure qui le recouvre se vaporise dans l’espace chaque fois
que son pied frappe le sol. Son corps fume. D’ailleurs il fonce le torse
incliné en avant comme s’il allait charger. Une fois parvenu à la table, il
saisit le verre de gin qu’il vide d’un trait à son tour, puis lance à Marianne,
qui déjà renoue son écharpe, viens.
La transplantation apparaît à tous les niveaux dans
ce roman. A un premier niveau qui est la transplantation du cœur de Simon. A un
deuxième niveau où la mort de Simon agira sur les existences de son entourage (la famille) et de ceux qui
l’entourent (corps médical), entrera d'une manière ou d'une autre dans le corps de chacun. A un troisième niveau, celui du lecteur qui, une fois plongé dans la lecture (est-ce lui qui plonge dans le texte ou le texte qui plonge en lui?), ne sera plus
tout à fait lui-même, plus tout à fait indemne.
Et si c'était cela la lecture : à
chaque fois une nouvelle transplantation ? Voir avec les yeux d’un autre,
sentir avec les capteurs d’un autre, éprouver les expériences des autres ; se greffer un nouveau monde à chaque livre. L’auteur
est donneur ; le texte chirurgien ; le lecteur transplanté – sauvé ?
Maylis de Kerangal, Réparer les vivants, éditions Verticales, 2014.